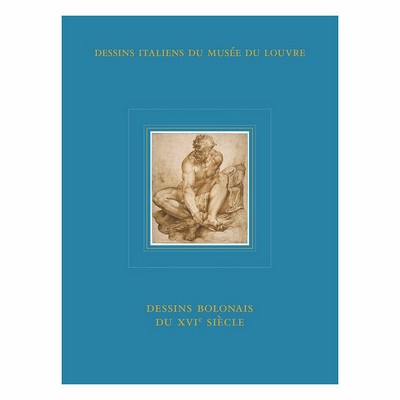De la Chine aux Arts Décoratifs. L'art chinois dans les collections du Musée des Arts décoratifs
Musée des Arts Décoratifs, Paris
13 février - 29 juin 2014
Brûle-parfum en forme de gui couvert,
Chine, dynastie Qing, période Qianlong (1736-1796)
Emaux cloisonnés et champlevés sur cuivre
Dépôt public Fondation Salomon de Rothschild, 1923
Musée des Arts décoratifs, Paris, photo Jean Tholance
De la Chine aux Arts Décoratifs retrace l’apparition du goût pour l’art chinois qui prend une ampleur manifeste en France au XIXe siècle, mais aussi l’histoire particulière d’une collection. Le Musée Chinois à Fontainebleau inauguré par l’Impératrice Eugénie en 1863, ou encore les Expositions Universelles, sont les prémices de ce nouvel et vif intérêt pour des formes d’art que ces amateurs éclairés vont, pour certains, collectionner avec passion.
Les premières salles de l’exposition rendent hommage à ces collectionneurs et ces légataires, tels que Jules Maciet, Raymond Koechlin, Jean Schlumberger, Raoul Duseigneur, Mademoiselle Grandjean, mais aussi David David-Weill et la Baronne Salomon de Rothschild. En faisant don au musée des Arts décoratifs, ils revendiquent le souci de préserver, valoriser et transmettre un répertoire esthétique nouveau, ainsi que les secrets de certaines techniques, comme la laque ou encore la porcelaine.
Aiguière, Chine, dynastie Ming, XVIe siècle
Porcelaine de Jingdezheng, monture en bronze doré
Don Alexis Rouart, 1898, Musée des Arts décoratifs, Paris
Les raisons données par David David-Weill, lorsqu’il offre ses émaux cloisonnés au musée en février 1923, valent sans doute pour chacun d’entre eux : « La collection (…) pourra être un enseignement utile pour toute une branche d’artistes décorateurs ». Cet art chinois prisé par les créateurs et les amateurs occidentaux offre la possibilité de renouveler les techniques et d’ouvrir la porte à un nouveau répertoire iconographique. Les représentations de dragons ou encore de « chiens Fô » et d’autres chimères sont, pour le public européen de l’époque, des figures étranges et cryptiques qui suscitent toute leur curiosité.
Double gourde (paire), Chine, dynastie Qing, laque, XVIIIe siècle
Dépôt public Fondation Salomon de Rothschild, 1923
Musée des Arts décoratifs, Paris
De la Chine aux Arts Décoratifs est l’occasion d’appréhender une collection qui révèle un héritage artistique inédit. A l’exception de pièces réalisées pendant les premières dynasties royales ou impériales chinoises, les objets exposés appartiennent aux dynasties des Song (960-1279), des Yuan (1279-1368) et, pour la majorité, aux deux dernières dynasties impériales, celles des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1912). Ces chefs-d’oeuvre datant des périodes les plus récentes sont parmi les plus prisés des collectionneurs de l’époque et forment ainsi une partie importante de l’exposition, permettant de se rendre compte de la finesse et de la richesse des fonds que conservent Les Arts Décoratifs. Le public est invité à admirer une grande diversité d’objets tels que des robes de cour (chaofu) ou de cérémonie (lifu), des habits semi-officiels (jifu), des armures, ou encore des textiles présentés sous forme d’échantillons plus ou moins grands, offrant un catalogue de motifs et de techniques extraordinaires qui ont fasciné les Européens. Des albums de papiers aquarellés du XVIIIe et du XIXe siècle, réalisés pour le marché occidental et illustrant le mode de vie et les décors chinois, sont sortis des archives de la bibliothèque des Arts Décoratifs pour l’occasion.

Plat, Chine, dynastie Yuan (1279-1368)
Porcelaine avec décor en bleu de cobalt sous couverte
Achat Raoul Duseigneur, 1894
Musée des Arts décoratifs, Paris
Deux salles sont dédiées aux céramiques d’exportation provenant majoritairement des collections d’Alexandrine Grandjean et de Paul Pannier et des périodes plus anciennes sont classées par techniques, et mettent à jour des pièces d’exception comme le grand plat Yuan en porcelaine avec un décor bleu de cobalt sous couverte. Au même titre, des jarres, des vases ou encore des pots à anse en céramique évoquent l’époque durant laquelle les Compagnies des Indes orientales importaient par millions ces objets en Europe, alors que cette dernière recherchait encore le secret de la porcelaine. Ce parcours à travers l’histoire de l’art chinois retrace également l’évolution du goût des collectionneurs qui penchent pendant un temps pour les décors richement constitués d’émaux polychromes, et plus tardivement pour des objets initialement destinés au commerce en Chine.
Brûle-parfum en forme de li ding, Chine, dynastie Qing
Bronze patiné, Achat Laurent Héliot, 1892
Musée des Arts décoratifs, Paris
Une autre partie de l’exposition, dédiée à un ensemble remarquable de cloisonnés provenant de dons de David David-Weill et de la Baronne Salomon de Rothschild, réunit l’une des collections les plus importantes de ce genre, très peu vues en Europe, offrant ainsi un panorama impressionnant qui retrace l’historique de cette technique. Ces chefs-d’oeuvre accompagnent des objets rares, tels qu’une vingtaine de cornes de rhinocéros sculptées appartenant aux dynasties Ming et Qing. Des pierres dures finement travaillées telles des vases, des pots et des coupes en jade, en agate et en lapis-lazuli sont également montrés au public et témoignent du raffinement de la culture chinoise. Aux côtés de ces pièces, s’ajoute une sélection d’éléments de mobilier dont des paravents qui rappellent la grande maitrise de la laque que les européens ont longtemps admirée des chinois.
L’exposition montre aussi des objets essentiellement fabriqués pour le marché chinois. Iconographies et symboliques des motifs sont décryptées au public pour mieux appréhender l’art et la culture de la Chine. Ces oeuvres figurant aujourd’hui au musée, sont ainsi l’occasion d’aborder les méthodes de création originales et anciennes, tout en distinguant le « goût chinois » de celui des français, dans la sphère des métiers d’art. En exposant cette collection, Les Arts Décoratifs souhaitent également apporter une ouverture sur la Chine du XXe siècle et contemporaine à travers des affiches et des jouets, mais aussi des oeuvres de designers ou de créateurs chinois.
En écho à l’exposition Les secrets de la laque Française. Le vernis Martin qui est installée dans la Nef du musée, De la Chine aux Arts Décoratifs s’étend dans les douze salles de la galerie d’étude, du 13 février à l’été 2014. Tout en mettant en lumière l’héritage du savoir-faire chinois et l’impact qu’il a eu sur les métiers d’art en Europe et en France en particulier, cet événement est ainsi l’occasion d’exposer une collection précieuse et riche, trop rarement montrée au public jusqu’à aujourd’hui.
Commissaire de l'exposition : Béatrice Quette, Musée des Arts décoratifs
MUSEE DES ARTS DECORATIFS
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
www.lesartsdecoratifs.fr