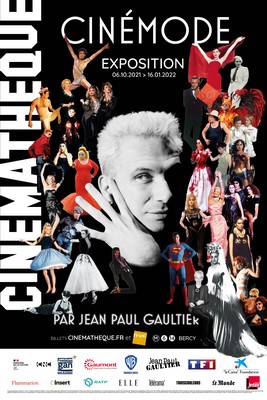mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou
Programmation Cinéma
Septembre → Décembre 2025
Photo © mk2
À partir de septembre 2025, et pendant les cinq années de rénovation du bâtiment historique du Centre Pompidou, les cinémas du Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire à la Bpi s'installent au mk2 Bibliothèque.
Les précédentes collaborations entre le Centre Pompidou et mk2, notamment la rétrospective intégrale et exposition « Abbas Kiarostami, les chemins de la liberté » en 2021, ainsi que l’exposition « Corps à Corps, Histoire(s) de la photographie » en 2023, qui mettait en dialogue la collection de photographies du Centre Pompidou− Musée national d’art moderne et celle de Marin Karmitz, fondateur de mk2, ont naturellement conduit à ce partenariat.
Rebaptisé et habillé aux couleurs du Centre Pompidou, l’actuel mk2 Bibliothèque (entrée BnF) situé au cœur du bâtiment de la Bibliothèque nationale de France François−Mitterrand, face à l’entrée de la bibliothèque, devient mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou et accueille dans ses quatre salles et son atrium rétrospectives, cycles, festivals, avant-premières, rendez-vous réguliers, rencontres et masterclasses conçus par le Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire de la Bibliothèque publique d’information. Ponctuellement, une partie de cette programmation prend également place au mk2 Bibliothèque, sur le parvis, à proximité immédiate.
La pluridisciplinarité qui définit le Centre Pompidou s’y incarne en une programmation de lectures, performances, concerts, installations, et créations XR à partir des images en mouvement.
À l’image de la collection du Musée national d’art moderne qu’il conserve, enrichit et expose, le Centre Pompidou s’attache, pour sa programmation cinéma, à la mise en avant de la création moderne et contemporaine internationale et à ses interactions avec la société. La programmation au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou est structurée par de grandes invitations à des cinéastes d’avant-garde, emblématiques comme moins repérés, à travers rétrospectives, commandes d’œuvres, expositions et publications, et ponctuée d’événements consacrés à des figures émergentes. Elle donne également une place importante à la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, développée depuis 2020 par le Centre Pompidou et les Ateliers Médicis avec rendez-vous mensuels, avant-premières, restaurations, weekends dédiés, workshops et séminaires.
Comme elles le faisaient dans le bâtiment historique du Centre Pompidou, les images en mouvement dialoguent avec d’autres formes de pensée et de création au sein de rencontres, festivals, performances et concerts pour rendre compte du croisement des pratiques, de l’élan et de la vitalité qu’il insuffle au cinéma, un art en constante mutation. En préfiguration du Centre Pompidou 2030, la programmation au mk2 Bibliothèque continue d’explorer ces mutations et est un laboratoire de nouvelles manières d’imaginer et de faire vivre la programmation du cinéma et autour du cinéma, dans toute la variété de ses formes artistiques, en mobilisant les ressources de la pluridisciplinarité qui font l’identité du Centre Pompidou. Dans cette perspective, la proximité immédiate avec la BnF est aussi l’opportunité de collaborations inédites autour des programmes, des fonds et des ressources des deux établissements.
Ours d'Argent du Meilleur Scénario à la Berlinale 2025
Sortie en salle le 24 septembre 2025
RADU JUDE, CINÉASTE INTRANQUILLE
RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE | AVANT-PREMIÈRES | MASTERCLASSE | RENCONTRES | LIVRE
23 septembre → 11 octobre 2025
EN PRÉSENCE DU CINÉASTE ET DE NOMBREUX INVITÉS
L’oeuvre du réalisateur roumain Radu Jude est, à bien des égards, le secret le mieux gardé de la cinéphilie contemporaine. Sa profusion et son amplitude – 28 films de tous formats depuis le début des années 2000, fictions, documents et expérimentations – ne sont parvenues en France qu'en petite partie, dans le sillage de l’Ours d’Or attribué en 2021 à Bad Luck Banging or Loony Porn à la Berlinale. Et pour cause : Radu Jude construit à une vitesse ébouriffante une filmographie qui traverse tous les territoires avec une grande fluidité formelle, bousculant le cinéma en le confrontant aux impasses mémorielles et aux aberrations actuelles pour le porter, avec la vigueur de la farce, à son plus haut degré d'intranquillité. Radu Jude s’est rapidement imposé comme l’une des voix les plus stimulantes du cinéma européen. Une Europe post-communiste et post-capitaliste, vue depuis la Roumanie, qui est précisément au centre de son travail et sur laquelle il pose un regard décapant, libre de toute allégeance et de toute bienséance.
Aussi singulière qu’elle soit, son oeuvre échappe à la définition tant elle est à la fois d’une immense fureur politique, d’une implacable précision historique, dialectique et filmique mais aussi d’une grande drôlerie, toujours impertinente et farcesque – Radu Jude reprenant à son compte la célèbre formule de Karl Marx selon laquelle l’histoire se répète toujours « la première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide ».
La clé, peut-être, pour appréhender cette oeuvre plurielle et fascinante est à chercher dans l’articulation de la colère intacte et palpable du cinéaste à son refus de tout cynisme, de toute paresse intellectuelle manichéenne comme de toute complaisance compassionnelle. Parce qu’il tient en haute estime le cinéma et ses spectateurs, il choisit plutôt de les confronter, avec un sérieux humour corrosif, à l’Histoire de l’Europe et à la mauvaise farce que joue un passé mal digéré – notamment dans ses documentaires et fictions sur le génocide des juifs par le pouvoir roumain pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le remarquable Peu m’importe si l’Histoire nous considère comme des barbares en 2018. C’est avec la même curiosité et la même lucidité qu’il embrasse à la fois les inventions du présent et ses violences multiples comme peu de cinéastes le font aujourd’hui – N’attendez pas trop de la fin du monde, en 2023, mettait ainsi en vis-à-vis l’exploitation au travail et le défouloir sur les réseaux sociaux.
Dans un carton initial de Caricaturana, un court métrage réalisé en 2021, Radu Jude cite Baudelaire à propos du caricaturiste Honoré Daumier, dans un quatrain qui pourrait aussi bien servir de portrait du cinéaste :
« C’est un satirique, un moqueur ;Mais l’énergie avec laquelleIl peint le Mal et sa séquelle,Prouve la beauté de son coeur »
Une rétrospective intégrale de son travail est présentée au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou, en présence du cinéaste et de nombreux invités. Cette dernière s’ouvre sur l’avant première de Kontinental ‘25 (Ours d’Argent du Meilleur Scénario, Berlinale 2025) dont la sortie en salles est assurée dans la foulée le 24 septembre 2025 par Météore Films et se clôture sur Dracula, film encore inédit de Radu Jude, présenté en première française avant sa sortie en salle le 15 octobre.
The Film Gallery présente parallèlement une exposition autour de Sleep #2 et The Exit of the Trains sous forme d’installation multi-écrans du 22 septembre au 25 octobre 2025.
Un livre, publié par les éditions de l'OEil et le FIDMarseille, en partenariat avec Le Centre Pompidou, paraît à cette occasion, rassemblant des extraits du journal du cinéaste, un long entretien et divers textes.
L’INVENTAIRE DELEUZE
CONFÉRENCES | PROJECTIONS | LECTURES | PERFORMANCES | ATELIERS | SÉANCES D’ÉCOUTE
7 novembre → 9 novembre 2025
« Un jour peut-être le siècle sera Deleuzien », écrivait Michel Foucault. Cent ans après la naissance de Gilles Deleuze, les échos de sa pensée sont au coeur des enjeux de l’époque, de la place des machines aux pulsations du désir, des devenirs-femmes émancipateurs à l’organisation des peurs par les néofascismes. À l’occasion de ce centenaire, le Centre Pompidou réunit aux côtés des lectrices et lecteurs de Deleuze de grandes voix de la création de tous horizons, français et internationaux.
S’inspirant de L'Abécédaire, série de dialogues télévisés avec Claire Parnet en fil rouge, l’inventaire des résonances contemporaines de l’oeuvre de Deleuze est dressé autour d’une programmation de conférences, projections, lectures, performances, ateliers et séances d’écoute. En parallèle, un colloque consacré à son ouvrage L’Image-temps dont c’est le quarantième anniversaire se déroule à l’université Paris 8 à partir du 5 novembre
Lecteur de Friedrich Nietzsche ou Baruch Spinoza, auteur avec Félix Guattari d’ouvrages où l’inconscient se fait révolutionnaire, Gilles Deleuze peuple la philosophie d’innombrables « personnages conceptuels ». Il y insuffle une inventivité dont la publication de ses cours fait aujourd’hui redécouvrir l’intensité vivante. Du vent de liberté né de mai 1968 à la lutte du peuple palestinien ou au développement de nouvelles formes de contrôle, sa pensée fut en prise directe avec les mouvements politiques de son temps : elle revient en boomerang interroger le nôtre.
Inspirateur d’innombrables artistes dans tous les domaines, cité tout autant par les peintres que par les musiciens ou les hackers, Gilles Deleuze fit du cinéma l’un des laboratoires de sa philosophie, et consacra deux grands livres au lien entre pensée et images – l’intervention qu’il donna à la FEMIS sur l’acte de création fit événement pour plus d’une génération de cinéastes. Quel meilleur cadre, alors, que des salles de cinéma pour faire résonner cet héritage et le conjuguer au futur ?
Aux côtés de L’Abécédaire et de la conférence à la FEMIS, d’autres films travaillant les archives audiovisuelles autour de Gilles Deleuze sont projetés – notamment ceux du duo d’artistes Silvia Maglioni et Graeme Thompson. L'artiste Frank Smith quant à lui, auteur de Deleuze Memories (2025), réalise un film spécialement pour l'occasion autour d'un texte de Deleuze. Il s’agit aussi d’explorer les concepts développés dans L’Image-temps et L’Image-mouvement à travers Europe 51 de Roberto Rossellini mais aussi des films contemporains (The Thoughts That Once We Had (2015) de Thom Andersen), de s’intéresser au contexte de certains moments clé de son parcours (l’université de Vincennes et la clinique de La Borde à travers des films documentaires) et enfin, de découvrir Gilles Deleuze acteur dans George qui ? de Michèle Rosier.
LA CINÉMATHÈQUE IDÉALE DES BANLIEUES DU MONDE
LE GRAND WEEK END
PROJECTIONS | RENCONTRES | AVANT-PREMIERES
14 novembre → 17 novembre 2025
Du 14 au 17 novembre, la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, portée depuis 2021 par les Ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil et le Centre Pompidou, qui questionne la représentation des périphéries à travers l’image en mouvement – se déploie au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou en même temps qu’au tout nouveau cinéma Alice Guy, à Bobigny, pour un weekend composé de projections et de rencontres.
Au programme, des avant-premières et des inédits, des films récemment restaurés, et l’occasion de retrouver de grands invités et les personnalités qui ont marqué l’année de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde.
© British Film Institute
© Malavida Films
DEREK JARMAN
RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE | RÉÉDITION DE FILMS REMASTÉRISÉS | PERFORMANCES | RENCONTRES
28 novembre → 16 décembre 2025
AVEC LA PARTICIPATION DE TILDA SWINTON ET DE NOMBREUX INVITÉS
Peintre, cinéaste, écrivain, militant des droits homosexuels, pionnier de la culture queer et jardinier : l’oeuvre de Derek Jarman s’incarne en de nombreuses formes et perspectives, faisant preuve d’une érudition considérable et d’une vitalité toujours renouvelée. Inscrits dans un continuum de pensée, de vie et de création, réalisés à l’époque du conservatisme thatchérien, ses films sont autant d’objets flamboyants qui confrontent les questions esthétiques et les problématiques sociales, chargés d’une force politique demeurant intacte. Le Centre Pompidou propose une rétrospective de ses longs métrages remastérisés - dont cinq ressortent parallèlement en salle grâce à Malavida Films - et de nombreux de ses courts en super 8, présentant la diversité de son geste, de la fiction à des formes personnelles, diaristiques ou expérimentales.
Parallèlement, la maison d'édition Actes Sud publie la traduction française de l'un des journaux de Derek Jarman, Modern Nature.
Alors que l’artiste, incarnant une figure de l’avant-garde et de l’underground anglais, a travaillé de façon extrêmement collective, entouré d’amis et de collaborateurs de longue date, cette rétrospective se veut polyphonique, peuplée de la parole de proches, dont Tilda Swinton, de témoins et d’héritiers, qui accompagnent de nombreuses séances.
Né en 1942 à Northwood, dans le Middlesex, Derek Jarman étudie à la Slade School of Fine Art (University College de Londres) et développe en premier lieu une pratique du film expérimental en 8mm. Il y reviendra régulièrement tout en travaillant en parallèle à la réalisation de longs métrages, pour lesquels il explore notamment des trames plus narratives. À commencer par Sebastiane (1976), autour du martyr de Saint Sébastien, premier film britannique avec des images positives de la sexualité gay. Son succès le plus retentissant, Caravaggio (1986), cinquième de ses longs métrages, est largement diffusé et lui vaut un Ours d’argent à la Berlinale. Ce film inaugure également sa collaboration avec l’actrice Tilda Swinton, ils feront huit films ensemble. La même année, sa séropositivité est diagnostiquée. Il en fait publiquement état ainsi que des traitements et de la maladie même, qui entraîne une cécité. Son dernier long métrage, Blue (1992), associe une riche bande sonore à un écran monochrome bleu. Ce film fait partie de la collection du Centre Pompidou, ainsi que trois courts métrages du cinéaste.
Derek Jarman, décédé en 1994, laisse une empreinte remarquable sur la création actuelle avec une oeuvre post-punk s’intéressant tout autant à la musique qu’à la peinture, au théâtre, à la poésie, à l’histoire, à la religion ou à la philosophie. Outre ses films, ses peintures ont fait l’objet d’expositions telle que « Dead Souls Whisper » au CRÉDAC (Ivry-Sur-Seine) en 2021. L’artiste a également laissé quantité d’écrits rendant compte de l’étendue de ses passions et de ses connaissances – scripts de ses films, journaux, ou encore un fabuleux texte sur les couleurs et leurs imaginaires, Chroma, rédigé alors qu’il perdait la vue. Dernier et fameux versant de son travail, le Prospect Cottage et son jardin sur la côte venteuse anglaise, dans le Kent, à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire de Dungeness. Au fil du temps, l’aménagement du lieu – fleurs et plantes sélectionnées pour survivre à un climat rigoureux, pieux de bois flotté, outils de jardinage, tableaux, sculptures – devient un symbole de son combat contre la maladie. C’est aussi un endroit de travail pour lui et ses amis, racheté en 2020 grâce à un appel aux dons en vue de sa préservation.
CENTRE POMPIDOU, PARIS