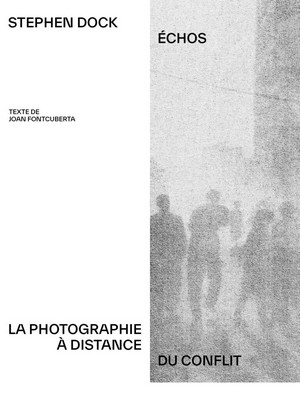Usimages 2025 - 6e édition - 10e anniversaire
Biennale de la photographie du patrimoine industriel et du travail
Agglomération Creil Sud Oise
12 avril - 15 juin 2025
sur le train de roulement d’un char Renault R40
Entre janvier et mai 1940
© Auteur inconnu/ECPAD/Défense
La 6ème édition d’Usimages, Biennale de la photographie du patrimoine industriel et du travail, aborde la thématique des transports à travers une programmation de 12 expositions réparties sur les communes du territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise.
Du 12 avril au 15 juin 2025, ces expositions en plein air s’installent dans les communes de Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny et Villers-Saint-Paul.
Le dérèglement climatique nous oblige à inventer et redéfinir les modalités de nos transports, afin d’en améliorer l’impact sur notre environnement. La mobilité, source de liberté et d’émancipation, permet à tout à chacun d’accéder à un emploi ou à ses loisirs, elle permet de créer du lien et des échanges.
La programmation d’Usimages s’attache à la création par l’invitation de photographes contemporains comme Stéphane Couturier, Marc Paygnard ou Sylvain Bonniol ou Dominique Leroux.
La biennale revisite des fonds photographiques grâce à des collaborations renouvelées comme avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, les Archives Nationales du Monde du travail, Le ministère des Armées ou L’Institut pour l’histoire de l’aluminium.
Usimages poursuit également son ouverture internationale avec l’invitation de la photographe québécoise Caroline Hayeur.
Enfin, le festival perpétue son soutien à la jeune création en proposant à Delphine Lefebvre et Loredana Marini de réaliser une résidence artistique dans quatre entreprises du bassin Creillois, présentée dans une grande exposition rétrospective de l’ensemble des photographes accueillis en entreprises depuis 10 ans.
Fort des contacts tissés au cours des cinq premières éditions, des actions de médiation diverses et innovantes sont proposées sur les lieux d’exposition, dans un programme de visites-ateliers dans chaque commune avec les publics scolaires et des groupes.
Toutes les expositions sont ouvertes au public gratuitement.
12 EXPOSITIONS
• Le passé roule pour l’avenir : aluminium et électricité
Légèreté et aérodynamisme des voitures électriques de Paul Arzens et de Jean-Albert Grégoire
En partenariat Institut pour l’histoire de l’aluminium
Co-commissariat : Nathalie Postic
• La fabrique du voyage
Les archives des Wagons-lits en partenariat avec Arthur Mettetal
• Matra, automatisation du transport
En partenariat avec Les Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix
• Les Archives de l’ECPAD
En partenariat avec l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, Les transports dans l’industrie de la défense
Co-commissariat : Daniel Coutelier
• François Kollar
Entreprise d’aviation UAT 1956
En partenariat avec La Médiathèque du patrimoine et de la photographie
Co-commissariat : Matthieu Rivallin
• Marc Paygnard
Alst’hommes
En partenariat avec le Musée Nicéphore Niepce
Co-commissariat : Sylvain Besson - Stéphane Couturier
Melting Point - Usine Toyota - Valenciennes - 2005
• Dominique Leroux
Dresseurs de métal
Construction du Charles de Gaulle
• Sylvain Bonniol
Visages d’un chantier naval, les Chantiers de l’Atlantique
• Caroline Hayeur
Les travailleurs de la Société de Transport de Montréal
Carte blanche avec Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (Québec)
• Résidences en entreprise
Pour l’édition 2025, deux jeunes photographes Delphine Lefebvre et Loredana Marini sont accueillies en résidence pour développer un travail de création dans trois entreprises de l’Agglomération Creil Sud Oise : BRM systems, Meiser, Socrec, et deux centres de formation : Laho Formations, lycée professionnel Donation Robert et Nelly de Rothschild.
En rétrospective, exposition des travaux des photographes accueillis en résidence en entreprise entre 2017 et 2021 : Vincent Marcq, Margaux Laurens, Romain Cavallin, Florian da Silva, Morgane Delfosse, Lucas Castel, Pauline Pastry, Emma Riviera.
• Atelier Photo de l’espace Matisse
Exposition des participants de l’atelier photo pour adultes encadré par Gaël Clariana
11 communes, lieux d'expositions
• Cramoisy, 8 rue du Pont, Berges du Thérain
• Creil, Île Saint-Maurice, Espace Matisse, Locaux de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
• Maysel, Place de la mairie
• Montataire, Square Pierre et Léa Léger
• Nogent-sur-Oise, Parc Hébert Rousseloy, Autour de l’étang
• Saint-Leu-d’Esserent, Coulée Verte
• Saint-Maximin, Place d’Octobre
• Saint-Vaast-lès-Mello, Pôle Louise Michel
• Thiverny, Place Roger Salengro
• Villers-Saint-Paul, Place de la mairie
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France