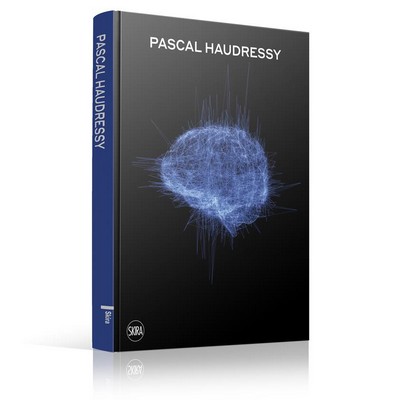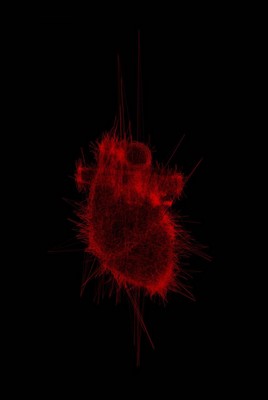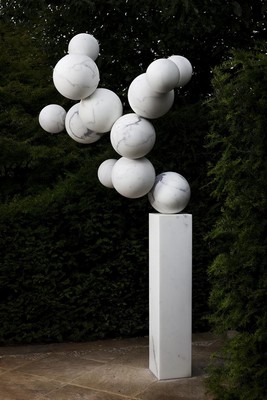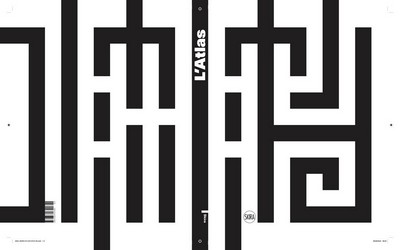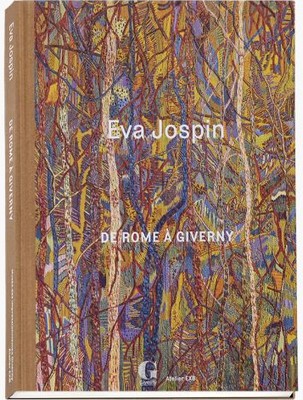Rétrospective Suzanne Duchamp
Kunsthaus Zürich
Jusqu'au 7 Septembre 2025
Le Kunsthaus Zürich consacre à SUZANNE DUCHAMP la première rétrospective au monde. Ses compositions minimalistes et pourtant graphiquement marquantes, associées à des titres suggestifs comme «Usine de mes pensées», sont entrées dans l’histoire de l’art et néanmoins source d’inspiration jusqu’à nos jours. Malgré son appartenance à l’une des familles d’artistes les plus célèbres, son oeuvre est restée jusqu’à présent largement inconnue du grand public. Cette exposition, qui réunit des prêts exceptionnels provenant d’institutions publiques et de collections privées renommées, rend à Suzanne Duchamp la place de premier plan qu’elle mérite.
Dadaïste, peintre, SUZANNE DUCHAMP (1889, Blainville-Crevon – 1963, Neuilly-sur-Seine) a laissé à la postérité une oeuvre aux multiples facettes dont certains éléments figurent dans des collections réputées, mais qui pour l’essentiel est surtout appréciée d’un public d’initié(e)s. Duchamp entretenait des liens étroits avec les avant-gardes de son époque et a enrichi l’histoire de l’art d’apports très personnels. Soeur de Marcel Duchamp, de Raymond Duchamp-Villon et de Jacques Villon, elle échangeait beaucoup avec eux. En 1919, elle a épousé l’artiste suisse Jean Crotti, dont le Kunsthaus Zürich possède des oeuvres clés, et avec qui Suzanne Duchamp a occasionnellement coopéré. La dernière exposition d’ampleur consacrée aux deux artistes a eu lieu en 1983 au Centre Pompidou, à Paris, en coopération avec la Kunsthalle Bern. Il est donc grand temps de mettre à l’honneur le travail de Suzanne Duchamp et d’en montrer toute la profondeur. Par son langage visuel subtil, esthétique et plein d’humour, elle incarne une combinaison hors du commun dans le mouvement dadaïste. Quelle ville conviendrait mieux que Zurich, cité natale de Dada, pour enfin donner à cette artiste d’exception toute l’attention qu’elle mérite?
SUZANNE DUCHAMP : À LA FOIS ABSTRAITE ET FIGURATIVE
Dans son art, Suzanne Duchamp a exploré des voies variées. À Paris, dans le sillage du cubisme, elle commence par se pencher sur la fragmentation d’intérieurs intimes et de paysages urbains, avant de se tourner vers le mouvement Dada. Ses oeuvres associent peinture et poésie dans une démarche expérimentale qui joue avec différents supports et matériaux.
Même si sa peinture évolue de plus en plus vers l’abstraction dans les années 1910, Suzanne Duchamp reste toujours fidèle à certains repères visuels, renforcés par des titres énigmatiques. En 1922, pour des raisons diffuses, elle rompt inopinément avec Dada pour se tourner vers une peinture figurative aux accents souvent ironiques et naïfs.
Dans les décennies qui suivent, elle crée des oeuvres contenant un large spectre de motifs, qui se caractérisent par des expérimentations sur les pigments et par l’importance structurante du dessin. En 1949, son influente amie Katherine S. Dreier la qualifie de « peintre semi-abstraite » – ce qui est une formulation pertinente pour une oeuvre échappant à toutes les conventions de l’histoire de l’art.
UNE EXPOSITION INTÉGRANT LES TOUTES DERNIÈRES RECHERCHES
Cette rétrospective réunit les oeuvres dadaïstes de Suzanne Duchamp et des travaux datant de ses phases antérieures et postérieures de création. Talia Kwartler, commissaire invitée, a étudié pendant plusieurs années l’oeuvre de Suzanne Duchamp et soutenu une thèse de doctorat sur cette artiste au University College de Londres. En 2024, elle a été chargée de cours à l’université de Zurich sur le thème des femmes dans le mouvement Dada.
La détermination de Talia Kwartler a permis de transformer la présentation prévue en une vaste rétrospective, la première jamais consacrée à cette artiste, élaborée avec Cathérine Hug, commissaire au Kunsthaus et spécialiste du mouvement Dada. L’exposition s’inscrit ainsi dans la longue tradition des présentations de Dada organisées au Kunsthaus Zürich depuis 1966, et peut être considérée comme un événement majeur dans la recherche en histoire de l’art. Réunissant près de 50 tableaux, 20 travaux sur papier ainsi que des documents d’archives rares et des photographies d’époque, cette rétrospective offre une vue d’ensemble de toute l’oeuvre de Suzanne Duchamp. De nombreux travaux n’ont été redécouverts qu’au terme d’intenses recherches. Parmi les prêteurs figurent des institutions comme le MoMA de New York, le Philadelphia Museum, l’Art Institute de Chicago, le Centre Pompidou de Paris, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris, le Musée des Beaux-Arts de Rouen, mais aussi d’importantes collections privées comme la Bluff Collection et la collection de Francis M. Naumann et Marie T. Keller. Cette rétrospective a vu le jour en étroite collaboration avec l’Association Duchamp Villon Crotti.
SUZANNE DUCHAMP : PUBLICATION
À l’occasion de l’exposition, la première monographie consacrée à Suzanne Duchamp vient de paraître, avec de nombreuses reproductions. L’ouvrage comporte une biographie détaillée rédigée par Talia Kwartler, ainsi que des articles d’historiennes de l’art comme Carole Boulbès, Cathérine Hug et Effie Rentzou, auxquels s’ajoutent des perspectives artistiques de Jean-Jacques Lebel (interview) et Amy Sillman (images). La postface est signée Anne Berest, autrice de best-sellers. Cet ouvrage de 192 pages est paru aux éditions Hatje Cantz.
Cette rétrospective est une coopération avec la Kunsthalle Schirn de Francfort (10 octobre 2025 - 11 janvier 2026), où le commissariat est assuré par Ingrid Pfeiffer.
KUNSTHAUS ZURICH
Heimplatz, 8001 Zurich
Retrospective Suzanne Duchamp
Kunsthaus Zürich, 6 Juin - 7 Septembre 2025