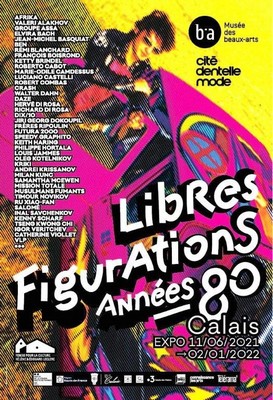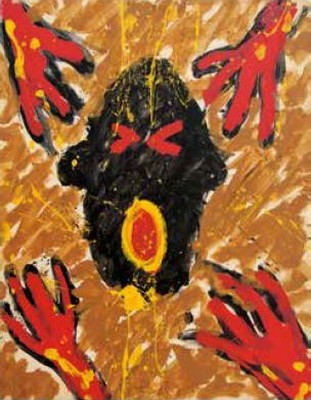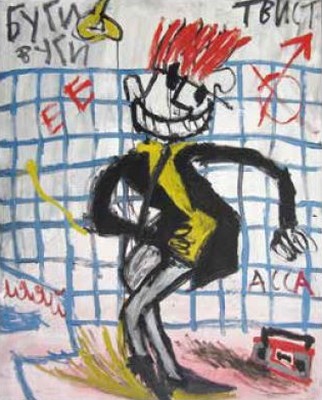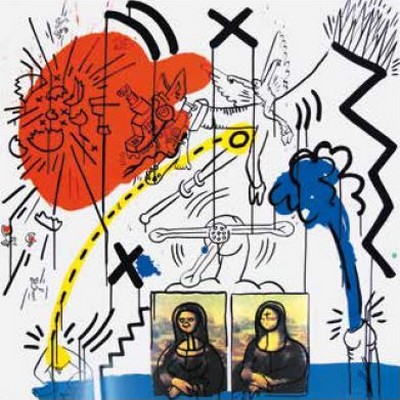Un été au bord de l’eau : loisirs et impressionnisme
Musée des Beaux-Arts de Caen
Jusqu'au 29 Septembre 2013
C'est l'une des plus grandes expositions de l'été 2013. Il suffirait pour s'en convaincre de jeter un coup d'oeil à la liste des artistes exposés (reproduite en fin de post) pour s'en convaincre. Les artistes impressionnistes ont bouleversé la peinture, et l'art en général, en la faisant entré dans la modernité. Et cette exposition au musée des Beaux-Arts de Caen nous les présente sur un de leur thème de prédilection. Un vrai bonheur.
Parmi les grandes mutations dont le 19e siècle fut témoin, le prodigieux essor des villégiatures et des loisirs de plein air est un phénomène qui concerne également l’histoire de l’art. Toute une société, qui se déplace volontiers en train, part à la conquête de nouveaux territoires : la côte, la plage, la mer… La Normandie mais bien d’autres régions également, vont prendre une part essentielle à cet engouement. Pour la première fois l’atelier du peintre quitte la ville, se transposant dans la nature même, signe marquant et prometteur. Désormais, avec les Impressionnistes, le sujet des tableaux ne se trouve plus dans les livres ou dans l’imaginaire des peintres mais au cœur de la réalité et de la vie, dans ces territoires nouvellement conquis, ces lieux de détente et de loisirs qu’offrent en si grand nombre les bords de l’eau.
L’exposition Un été au bord de l’eau : loisirs et impressionnisme décline son propos en quatre chapitres qui illustrent les différents modes d’exploration de ces thèmes par le peintre, depuis les scènes de plage, les paysages de bord de mer et leurs infinies variations atmosphériques, jusqu’à l’incursion des corps dévêtus dans un paysage marin ; devenus sujets exclusifs d’étude du peintre, ces corps solaires consacrent la métamorphose du nu académique, conjuguant tradition et modernité.
Les impressionnistes sur le sable
La plage devient naturellement un espace privilégié par les premiers vacanciers à la découverte des plaisirs de la mer. Sous le Second Empire, les villages de pêcheurs deviennent en quelques années de mondaines stations balnéaires, voyant apparaître riches villas et luxueux hôtels. A la recherche de dépaysement et de pittoresque, les vacanciers s'appliquent paradoxalement à reconstituer la société parisienne sur les plages normandes qui deviennent bientôt le « boulevard d'été de Paris ».
MARY CASSATT
Enfants jouant sur la plage, 1884
Huile sur toile ; 97,4 x 74,2 cm
Washington, National Gallery of Art, Alisa Mellon Bruce Collection
© National Gallery of Art, Washington
PAUL-CESAR HELLEU
Madame Helleu lisant sur la plage, 1896
Huile sur toile ; 81 x 65 cm
Bayonne, Musée Bonnat-Helleu, legs Howard-Johnston 2009
© Musée Bonnat-Helleu, Bayonne / photo A. Vaquero
JOAQUIN SOROLLA
Instantanea, Biarritz, 1906
Huile sur toile ; 62 x 93,5 cm
Madrid, Musée Sorolla
© Fondation Museo Sorolla, Madrid
Lors de leurs séjours, Edouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas, vont réaliser des scènes de plages suggestives, conçues comme des esquisses libres et spontanées. Sous l'influence de Boudin, Claude Monet peint les plages de Trouville et de Sainte-Adresse, inaugurant un genre enrichi par les expériences de Manet à Boulogne ou Gauguin en Bretagne… Cette séquence évoquera aussi les peintres réalistes et descriptifs tels Prinet, Blanche, Helleu, qui mènent aux interprétations lumineuses de Maurice Denis, séduisant metteur en scène de sa famille lors de ses séjours réguliers à Perros-Guirec. Gardons-nous aussi d’oublier les importantes contributions des peintres étrangers tels que Kroyer, Liebermann, et l’espagnol Joaquin Sorolla…
Les impressionnistes et le spectacle de l’eau
Sous l’effet du tourisme, la côte se transforme et les plages se couvrent de cabines de bain, abri indispensable pour se préparer à affronter les vagues. On se baigne et on se promène vêtu, avec une ombrelle, par décence mais aussi parce que le teint clair demeure la fierté des classes aisées. Les peintres plantent leur chevalet le long des promenades ou directement sur la plage, à l’affut de sensations nouvelles. On a retrouvé du sable dans la pâte des tableaux de Monet. Le genre qu’est devenue la marine se régénère avec la présence de promeneurs en quête de panoramas dégagés. La promenade en mer offre des points de vue inédits, certains peintres comme Monet ou Bonnard, représentent des scènes depuis les embarcations elles-mêmes.
BERTHE MORISOT
Vue du petit port de Lorient, 1869
Huile sur toile ; 43,5 x 73 cm
Washington, National Gallery of Art, Alisa Mellon Bruce Collection
© National Gallery of Art, Washington
Les impressionnistes : Barques et voiles
Simples barques, voiliers, yachts, vont captiver les peintres, pour eux-mêmes mais surtout pour les activités qu’ils permettent, courses, régates, promenades. L’installation de Monet à Argenteuil, au bord de la Seine, en 1871, est décisive ; les nombreux artistes qui le rejoignent vont offrir à l’impressionnisme l’un de ses chapitres les plus créatifs.
FRANCOIS BOCION
La promenade devant Chillon, 1868
Huile sur bois ; 29,5 x 45 cm
Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage, Don du Dr Michel Bugnion, 2000
© Fondation de l’Hermitage, Lausanne / photo Arnaud Conne, Lausanne
CLAUDE MONET
Voiliers en mer, 1868
Huile sur toile ; 50 x 61 cm
Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, Legs de Mlle Edwige Guyot
© Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne / photo J-C. Ducret
JOHN SINGER SARGENT
Deux femmes endormies dans une barque sous les saules, 1887
Huile sur toile ; 58 x 68,5 cm
Lisbonne, Museu Calouste Gulbenkian
© Musée Calouste Gulbenkian / photo Catarina Gomes Ferreira
Les impressionnistes au bain… A l'eau !
Cette dernière section, point d'orgue de l'exposition, rassemblera de grandes illustrations du thème, aux compositions souvent ambitieuses. Cette séquence nous éloignera des rivages normands, rappelant que l’Impressionnisme possède un volet méditerranéen. En cherchant la confrontation avec le grand genre et sa tradition séculaire, les peintres s’approprient le traitement académique du nu pour le transcender et peindre les corps en pleine lumière, sous le soleil, au sein d'une nature triomphante. On retrouve là Frédéric Bazille, Edgar Degas avec ses étranges Petites paysannes se baignant à la mer vers le soir, baigneuses nues privées de toute inhibition, Georges Seurat (remarquable série d’ébauches pour son chef-d’œuvre, Baignade à Asnières), Henri-Edmond Cross, un inattendu Frantisek Kupka, et bien sûr Auguste Renoir, Paul Cézanne, les plus assidus dans ce genre. Tous deux s’efforcent de placer la figure au centre de leur pensée et de leur esthétique: plénitude solaire et voluptueuse chez Renoir, recherches de structures et de rythmes chez Cézanne. Souvenons-nous qu’avec ses séries des Baigneurs, ce dernier allait marquer un jalon essentiel dans l’aventure de la modernité, passant magistralement le relais à Matisse, Picasso…

EDGAR DEGAS
Petites paysannes se baignant à la mer, vers le soir, 1875-1876
Huile sur toile ; 65 x 81 cm
Collection privée
© Photography Bryan Rutledge B.A.
FREDERIC BAZILLE
Pêcheur à l’épervier, 1868
Huile sur toile ; 134 x 83 cm
Arp Museum Bahnhof Rolandsec, collection Rau pour l’UNICEF
© Collection Rau pour l’UNICEF / photo Peter Schälchli, Zurich
AUGUSTE RENOIR
Baigneuse aux cheveux longs, Vers 1895
Huile sur toile ; 82 x 65 cm
Paris, musée de l’Orangerie
© Rmn-Grand Palais / Franck Raux
Catalogue de l’exposition
22 x 28 cm, 144 pages, 100 illustrations, broché
Editions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris 2013
Sommaire du catalogue de l'exposition :
Essais
L’atelier du peintre, par André Rauch, professeur émérite de l’Université de Strasbourg
Plages impressionnistes : sujet moderne et tradition, par Sylvie Patry, conservateur en chef du patrimoine, musée d’Orsay
Salons… avec vue sur les plages, par Dominique Lobstein, historien de l’art, ancien responsable de la Bibliothèque du Musée d’Orsay
Oeuvres exposées, catalogue établi par :
Patrick Ramade, commissaire de l’exposition et directeur du Musée des Beaux-Arts de Caen
Alice Gandin, conservateur du Patrimoine, Musée de Normandie, Caen
Christophe Marcheteau, attaché de conservation, Musée des Beaux-Arts, Caen
Prélude
Sur le sable
Le spectacle de l’eau
Barques et voiles
A l’eau !
Epilogue
Notes
Liste des œuvres exposées
Bibliographie
Commissaire de l'exposition :
Patrick Ramade, Directeur du musée des Beaux-Arts de Caen
Liste des peintres exposés :
Louise Abbéma (Etampes, 1853 - Paris, 1927)
Charles Théophile Angrand (Criquetot-sur-Ouville, 1854 - Rouen, 1926)
Frédéric Bazille (Montpellier, 1841 - Beaune-la-Rolande, Loiret, 1870)
Jacques-Emile Blanche (Paris, 1861 - Offranville, 1942)
François Bocion (Lausanne, Suisse, 1818 - Lausanne, 1890)
Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947)
Eugène Boudin (Honfleur, 1828 - Deauville, 1898)
Mary Cassatt (Allegheny City, Etats-Unis, 1844 - Mesnil-Théribus, 1926)
Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839 - Aix-en-Provence, 1906)
Henri-Edmond Cross (Douai, 1856 - Saint-Clair, 1910)
Edgar Degas (Paris, 1834 - Paris, 1917)
Maurice Denis (Granville, 1870 - Saint-Germain-en-Laye, 1943)
Louis-Alexandre Dubourg (Honfleur, 1821 - Honfleur, 1891)
Ernest-Ange Duez (Paris, 1843 - Bougival, 1896)
Paul Gauguin (Paris, 1848 - Atuona, îles Marquises, 1903)
Paul-César Helleu (Vannes, 1859 - Paris, 1927)
Peder Severin Krøyer (Stavanger, Norvège, 1851 - Skagen, Danemark, 1909)
František Kupka (Opočno, République Tchèque, 1871 - Puteaux, 1957)
Lucien Laurent-Gsell, dit Laurent-Gsell (Paris, 1860 - Paris, 1944)
Eugène-Modeste-Edmond Poidevin, dit Le Poittevin (Paris, 1806 - Auteuil, 1870)
Max Liebermann (Berlin, Allemagne, 1847 - Berlin, 1935)
Edouard Manet (Paris, 1832 - Paris, 1883)
Henri Matisse (Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954)
James Abbott Mc Neill Whistler (Lowell, Etats-Unis, 1834 - Londres, Royaume-Uni 1903)
Claude Monet (Paris, 1840 - Giverny, 1926)
Berthe Morisot (Bourges, 1841 - Paris, 1895)
Charles Mozin (Paris, 1806 - Trouville-sur-Mer, 1862)
Edward Henry Potthast (Cincinnati, Etats-Unis, 1857 - New York, 1927)
René-Xavier Prinet (Vitry-le-François, 1861 - Bourbonne-les-Bains, 1946)
Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841 - Cagnes, 1919)
John Singer Sargent (Florence, Italie, 1856 - Londres, Royaume-Uni, 1925)
Georges Seurat (Paris, 1859 - Paris, 1891)
Joaquín Sorolla y Bastida (Valence, Espagne, 1863 - Cercedilla, 1923)
Carl Spitzweg (Unterpfaffenhofen, Allemagne, 1808 - Munich, 1885)
Alfred Stevens (Bruxelles, Belgique, 1923 - Paris, 1906)
Félix Valloton (Lausanne, Suisse, 1865 - Neuilly, 1925)
Théo van Rysselberghe (Gand, Belgique, 1862 - Saint-Clair, 1926)
Jacques-Emile Villon (Damville, 1875 - Puteaux, 1963)
Otto von Thoren (Vienne, Autriche, 1828 - Paris, 1889)
Jens Ferdinand Willumsen (Copenhague, Danemark, 1863 - Cannes, 1958)
Un été au bord de l’eau : loisirs et impressionnisme est organisée par la Ville de Caen / Musée des Beaux-Arts de Caen et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris, dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste. Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des musées de France.
Horaires : tous les jours de 10h à 18h.
Musée des Beaux-Arts de Caen
Le Château, 14000 Caen
Site internet :
www.mba.caen.fr