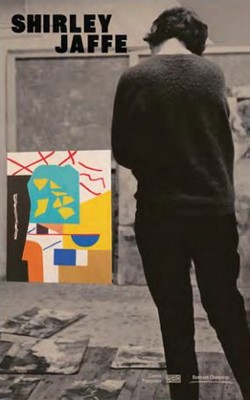Wolfgang Tillmans
Rien ne nous y préparait – Tout nous y préparait
Centre Pompidou, Paris
13 juin - 22 septembre 2025
© Centre Pompidou
Moon in Earthlight, 2015
Courtesy Galerie Buchholz,, Galerie Chantal Crousel, Paris,
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
it's only love give it away, 2005
Courtesy Galerie Buchholz,, Galerie Chantal Crousel, Paris,
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
Le Centre Pompidou donne carte blanche à l’artiste allemand Wolfgang Tillmans qui imagine un projet inédit pour clôturer la programmation du bâtiment parisien. Il investit les 6000 m2 du niveau 2 de la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et y opère une transformation de l'espace autour d’une expérimentation curatoriale qui met en dialogue son œuvre avec l’espace de la bibliothèque, le questionnant à la fois comme architecture et comme lieu de transmission du savoir.
L’exposition explore près de 40 ans de pratiques artistiques à travers divers genres photographiques, une rétrospective dont l’ordre et la logique se réalisent en réagissant à l’espace de la bibliothèque. Son œuvre s’y décline en des formes très variées et joue sur la verticalité des murs et l’horizontalité des tables, défiant ainsi toute tentative de catégorisation. Outre son travail photographique, Wolfgang Tillmans intègre dans cette vaste installation des œuvres vidéo, musique, son et textes, dans une scénographie qui joue avec les dispositifs d’une bibliothèque pour y découvrir enfin des analogies entre son travail d’artiste et ce lieu des savoirs. Plus que jamais l’artiste fera preuve de son don d’intervenir dans l’espace – une qualité qui distingue ces expositions depuis 1993.
Empire (US/Mexico border), 2005
Courtesy Galerie Buchholz,, Galerie Chantal Crousel, Paris,
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
My 25 Year Old Cactus, 2023
Courtesy Galerie Buchholz,, Galerie Chantal Crousel, Paris,
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
Intermodal Container In Mongolian Landscape, a, 2023
Courtesy Galerie Buchholz,, Galerie Chantal Crousel, Paris,
Maureen Paley, London, David Zwirner, New York
Au cours de sa carrière artistique, Wolfgang Tillmans (né en 1968 à Remscheid, en Allemagne) a repoussé les frontières du visible, captant et révélant la beauté fragile du monde physique. Proposant de nouvelles façons de faire des images, il explore la profonde transformation des médiums et supports d’information de notre époque. Il a ainsi façonné un univers esthétique distinctif, né de l’esprit de la contre-culture du début des années 1990. Une œuvre multiple, par laquelle il s’est engagé dans la quête d’un nouvel humanisme et de voies alternatives du vivre ensemble, influençant durablement la création contemporaine. Son travail est profondément ancré dans l’« Ici et Maintenant » : il dresse un panorama des formes de savoir et propose une expérience sincère et libre du monde, scrutant la condition contemporaine de l’Europe tout en explorant les techniques de reproduction mécanique.
En rapprochant les archives de l’artiste de ses œuvres les plus récentes, l’exposition du Centre Pompidou met en exergue les dialectiques qui traversent le monde depuis 1989 : les avancées sociales et les libertés autrefois établies, aujourd’hui en péril, les nouvelles manières de faire communauté ou encore les évolutions des expressions de la culture populaire et modes de diffusion de l’information. Wolfgang Tillmans conçoit cette exposition comme un ensemble et crée des œuvres spécifiquement pour le lieu.
L’un des aspects les plus originaux du travail de Wolfgang Tillmans est son regard égalitaire sur le monde. Alors que l’histoire de l’art repose souvent sur une hiérarchie des genres (le portrait noble, la nature morte modeste, la grandeur du paysage, etc.), Tillmans renverse cette logique. Dans ses expositions, des portraits d’amis ou d’amants côtoient des natures mortes banales, des photos de manifestations politiques ou encore des vues abstraites de plis de tissus, de corps ou de ciel.
Ce geste est profondément démocratique : chaque sujet, aussi ordinaire ou marginal soit-il, mérite d’être montré. Il adopte souvent un style documentaire, mais sans jamais céder à la tentation du sensationnalisme ou du voyeurisme. Il s'agit d'une photographie qui regarde avec respect, qui observe avec attention, sans juger. Cette approche sensible produit une éthique de l’image fondée sur la proximité plutôt que sur la domination.
Ce qui distingue également Wolfgang Tillmans, c’est sa manière de questionner le médium photographique lui-même. Il ne se contente pas de produire des images : il interroge ce que signifie faire une image, ce que c’est qu’une photographie. Il explore les possibilités techniques et matérielles du médium. Dans sa série Freischwimmer, par exemple, il crée des œuvres sans appareil photo : il expose directement du papier photo à des sources lumineuses en chambre noire. Le résultat : des formes organiques, flottantes, abstraites, qui évoquent des corps ou des fluides, sans jamais les représenter.
Il assume également les erreurs techniques : poussières, traces, flous, surexpositions deviennent des éléments esthétiques à part entière. Il refuse ainsi l’illusion d’une image parfaite, contrôlée, lisse. Chez Tillmans, la photographie n’est pas une fenêtre transparente sur le monde, mais une surface haptique, matérielle, expressive.
Chez Wolfgang Tillmans, l’image ne se limite jamais à elle-même : elle s’inscrit toujours dans une composition spatiale, dans une mise en relation. Ses expositions ne suivent ni une logique thématique, ni chronologique. Il joue avec les formats, les échelles, les supports. Certains tirages sont accrochés à même le mur avec de simples bandes adhésives, d’autres sont encadrés, parfois surdimensionnés.
Cette diversité crée une polyphonie visuelle, une narration ouverte, fragmentaire. Le spectateur ne suit pas un parcours imposé, il doit tisser lui-même des connexions entre les images, inventer son propre chemin. En ce sens, la mise en exposition fait partie intégrante de son œuvre : elle devient un acte de création à part entière, et non un simple dispositif de présentation. Par ce geste, Wolfgang Tillmans remet en question les conventions muséales et propose une nouvelle manière de faire l’expérience de la photographie dans l’espace.
Bien qu’il ne se revendique pas comme un artiste politique au sens classique du terme, l’œuvre de Wolfgang Tillmans est profondément engagée. Son engagement passe par les sujets qu’il aborde : la communauté LGBTQ+, la sexualité, l’épidémie du sida, la jeunesse, les migrations, l’Europe, le climat. Mais il ne traite jamais ces sujets sur un mode spectaculaire ou militant. Il les évoque avec délicatesse, à travers des gestes simples, des regards, des fragments de vie.
Son activisme devient plus explicite lors du référendum sur le Brexit : en 2016, il lance sa propre campagne visuelle (“Say you’re in if you’re in”), mêlant graphisme et photographie pour défendre le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Dans les années suivantes, il continue à mêler images et textes dans des installations qui prennent position sans dogmatisme, avec un souci constant de nuance et de proximité humaine. Ainsi, Wolfgang Tillmans pense le politique comme une affaire de sensibilité, comme un art de la relation, de l’écoute, de la présence au monde.
Ces dernières années, Wolfgang Tillmans a fait l’objet de rétrospectives majeures dans de grandes institutions, notamment à la Tate Modern de Londres en 2017 et au MoMA de New York en 2022. Il a également présenté une importante exposition itinérante sur le continent africain intitulée « Fragile » (2018 − 2022 à Kinshasa, Nairobi, Johannesburg, Addis Ababa, Yaoundé, Accra, Abidjan, Lagos). L’exposition au Centre Pompidou est la première monographie institutionnelle à Paris depuis son ambitieuse installation au Palais de Tokyo en 2002. Elle est accompagnée d’un catalogue et de la publication d’une version augmentée et traduite en français du Tillmans’Reader, regroupant divers textes et entretiens de l’artiste.
Commissariat de l'exposition : Florian Ebner, conservateur en chef, cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne − Centre Pompidou
Commissaires associés
Olga Frydryszak-Rétat, Matthias Pfaller, attaché(e)s de conservation au cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne − Centre Pompidou
ACCÈS LIBRE PAR CELINE
Partenaire Principal de l’exposition, la maison CELINE s’associe au Centre Pompidou, pour la première fois, au travers des journées « ACCÈS LIBRE par CELINE » : plusieurs journées d’accès gratuit imaginées comme une invitation ouverte à tous les publics. Ce projet a été pensé comme une initiative unique de partenariat qui offre à chacun l’occasion de découvrir l’univers de Wolfgang Tillmans tout en profitant, avant sa fermeture, du Centre Pompidou et de ses espaces.